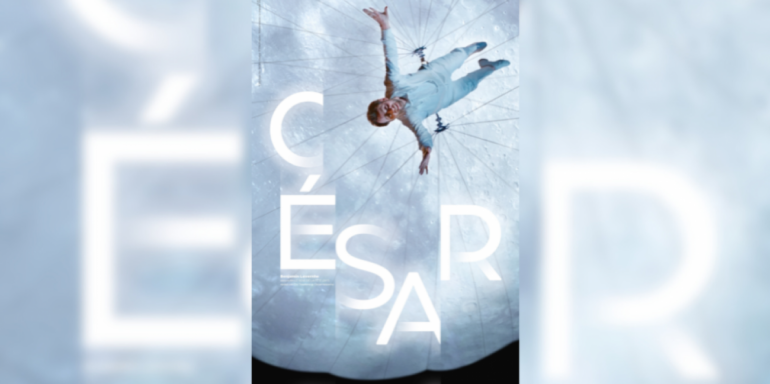Auditeurs:
Meilleurs auditeurs :
-
 play_arrow
play_arrow
SPEED RADIO Là où les artistes prennent la parole
-
 play_arrow
play_arrow
SPEED Belgique
-
 play_arrow
play_arrow
SPEED Paris Île-de-France
-
 play_arrow
play_arrow
SPEED Vaucluse
-
 play_arrow
play_arrow
SPEED Alsace
-
 play_arrow
play_arrow
Stand-Up Story avec Violaine de Pins SPEED RADIO

En juillet, Avignon change de visage. Ce n’est plus seulement une ville du Sud aux ruelles ombragées et aux places baignées de lumière. C’est une ruche. Une scène vivante, parfois démesurée, où l’on croise autant de tracts que de cafés, autant d’artistes que de spectateurs. Depuis plus de soixante-quinze ans, le Festival d’Avignon est un rendez-vous incontournable pour le théâtre. Mais ce festival-là, en cache deux. Il y a le In, l’institution fondée par Jean Vilar. Et il y a le Off, né dans son sillage, porté par des voix libres, indépendantes, souvent en marge. Leur histoire est faite d’échos, de contrastes, d’influences croisées. Et elle raconte, mieux que tout, l’évolution du spectacle vivant en France.
Jean Vilar et la naissance d’un théâtre pour tous
Pour comprendre l’origine du Festival d’Avignon, il faut revenir à l’été 1947. À l’époque, la France se relève lentement de la guerre. Jean Vilar, alors jeune metteur en scène, est invité à présenter Richard II de Shakespeare dans le cadre d’une exposition d’art contemporain, dans la Cour d’honneur du Palais des papes. C’est un choc : le lieu impose, la représentation marque. Vilar voit là plus qu’un décor exceptionnel il entrevoit un projet. Celui d’un théâtre ancré dans un lieu symbolique, mais ouvert à tous.
Dans les années suivantes, il bâtit peu à peu ce qui deviendra le Festival d’Avignon : un espace d’art exigeant, mais populaire. Vilar n’en fait pas un événement mondain, ni une vitrine élitiste. Son idée est simple, presque politique : offrir au plus grand nombre un théâtre vivant, accessible, capable d’élever, de rassembler. Il invente une forme de service public culturel. Le Festival In est né de cette vision : un théâtre dans le patrimoine, au cœur de la cité, pensé pour être vu par tous pas seulement par ceux qui savent déjà.
Le Off : une réponse spontanée, une liberté revendiquée
Mais l’histoire ne s’écrit jamais en ligne droite. Dès les années 60, certaines compagnies non retenues dans la programmation officielle prennent leur destin en main. Elles viennent quand même, trouvent des lieux, investissent des cafés, des arrière-cours, des chapelles désaffectées. Elles jouent sans autorisation, sans subvention, sans filet. C’est un théâtre brut, souvent expérimental, parfois militant. Peu à peu, cette contre-proposition prend forme et attire un public curieux. En 1966, un premier « mini-off » voit le jour. Il faut attendre les années 70 pour que le phénomène prenne vraiment son nom et son ampleur : le Festival Off d’Avignon devient un événement à part entière.
Ce qui distingue le Off, ce n’est pas seulement son mode d’organisation, plus libre, plus spontané. C’est surtout sa philosophie : pas de sélection artistique centrale, pas de hiérarchie entre les œuvres. Chaque compagnie est libre de venir jouer à condition de trouver un lieu et de supporter les coûts. Cela fait du Off un espace de risque : on y tente, on y découvre, on s’y rate parfois, mais c’est aussi là que de nombreux talents émergent. Il devient un terrain d’expression pour les jeunes créateurs, les formes hybrides, les esthétiques alternatives.
Une cohabitation électrique mais féconde
Le In et le Off se sont longtemps regardés en chiens de faïence. Le premier accusé d’élitisme, de verrouiller la création ; le second soupçonné de désordre, d’amateurisme ou de foire commerciale. Mais derrière les caricatures, il y a une réalité plus complexe : le In et le Off n’ont pas la même fonction, ni les mêmes moyens mais ils partagent un public, des professionnels, et une même passion pour la scène.
Le In, avec sa programmation très encadrée, invite de grands noms du théâtre contemporain. Il commande souvent des créations ambitieuses, parfois déconcertantes. Il attire un public fidèle, averti, souvent venu de loin. Le Off, lui, est un bouillonnement permanent : plus de 1 500 spectacles, des salles de 20 à 200 places, une liberté totale des genres et des styles. Les spectateurs y picorent, prennent des risques, découvrent des pépites.
Aujourd’hui, beaucoup d’artistes circulent entre les deux festivals au cours de leur carrière. Certains passent du Off au In, d’autres font le chemin inverse. La frontière s’est assouplie, même si les modèles restent très différents.
Un miroir des enjeux du théâtre contemporain
Ce face-à-face entre le In et le Off dit beaucoup de notre rapport au théâtre, à la culture, à la création. Le In symbolise une forme de théâtre pensé dans la durée, porté par des institutions, ancré dans une certaine vision de l’art. Le Off, à l’inverse, incarne l’urgence de jouer, l’envie de créer coûte que coûte, même sans réseau, sans moyens, sans reconnaissance immédiate.
Mais cette liberté a un prix. Les artistes du Off prennent souvent des risques financiers importants. Beaucoup y laissent de l’argent, parfois même leur équilibre. La précarité est une réalité. La profession s’interroge : comment préserver la richesse du Off sans l’épuiser ? Comment garantir que la diversité des formes ne se fasse pas au détriment des conditions de travail ? Le débat est ouvert.
Un futur à réinventer ensemble
Alors que les grandes institutions culturelles sont bousculées, que les modèles économiques évoluent, la relation entre le In et le Off reste plus actuelle que jamais. Elle interroge : qu’est-ce qu’un théâtre vivant aujourd’hui ? Un théâtre pensé en laboratoire ? Un théâtre de rue, de proximité ? Un théâtre qui dérange, ou qui rassemble ? À Avignon, chaque été, ces questions ne sont pas théoriques : elles se vivent, elles se jouent.
Peut-être est-ce là la véritable force de ce double festival : tenir ensemble deux pôles, deux énergies, deux façons d’aimer le théâtre. L’un ne va plus sans l’autre. Et c’est cette tension créative, parfois inconfortable, qui continue de faire d’Avignon le cœur battant du spectacle vivant en France.
Écrit par: SPEED
Articles similaires
Articles Populaire